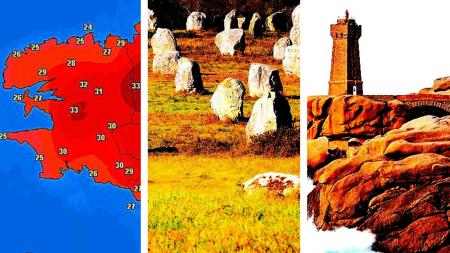France Travail a diffusé en avril 2025 son enquête annuelle auprès des employeurs sur leurs besoins en main-d’œuvre. Malgré une diminution significative des projets d’embauche dans tous les secteurs d’activité (-12,5 % par rapport à l’année précédente) et une moindre anticipation de difficultés de recrutement (-7 points), près de 40 % des employeurs ayant effectivement cherché à recruter déclarent, malgré tout, avoir rencontré des difficultés. 70 % d’entre eux imputent ces difficultés de recrutement à un trop faible nombre – voire une inexistence – de candidatures et à une inadéquation de ces candidatures à leurs attentes (manque d’expérience, de motivation, de compétences).
La même enquête révèle que près de 20 % de ces employeurs ayant cherché à recruter ont également rencontré des difficultés pour garder leur personnel. Cette situation peut sembler paradoxale au regard du taux de chômage qui reste élevé en France et du fait que plus de 2 millions de personnes y sont durablement éloignées de l’emploi.
La responsabilité des employeurs
Mais alors ce déséquilibre sur le marché de l’emploi est-il essentiellement lié à une inadaptation de l’offre de travail à la demande des employeurs, autrement dit à un problème d’employabilité d’une partie de la main-d’œuvre ? Ne peut-on pas également questionner la capacité des employeurs à être suffisamment attractifs, à recruter convenablement, à s’adapter à la main-d’œuvre disponible localement, à proposer des conditions de travail acceptables, à former, motiver et ainsi conserver leur personnel, à gérer la relation d’emploi de manière efficace et durable ? C’est en référence à cette seconde approche que le terme d’« employeurabilité » a été forgé, en miroir de celui d’employabilité. Il s’agissait de pointer la part de responsabilité des employeurs et d’esquisser, d’une certaine manière, le profil du « bon employeur ».
Apparue pour la première fois en France en 1999 sous la plume d’un consultant en ressources humaines, reprise et approfondie ensuite par quelques rares économistes, ce n’est qu’à partir de 2018 que la notion d’employeurabilité a connu un relatif essor en France, particulièrement portée par la diffusion du rapport Borello sur l’inclusion professionnelle, par le projet employeurabilité du Pacte civique ainsi que le rapport de préfiguration de France Travail.
Confusion dans les notions
Peu traitée par la recherche académique, la notion d’employeurabilité pâtit d’une insuffisance de caractérisation conceptuelle. Ce flou dans les contours de la notion est accentué par des recouvrements avec d’autres notions proches parmi lesquelles la marque employeur, la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), ou encore la qualité de l’emploi.
Il est vrai que la manière dont une entreprise communique sur ses leviers d’attractivité, la force de ses engagements sociétaux et la qualité des emplois qu’elle propose va significativement influer sur sa capacité à recruter. Mais certains écrits sur la notion d’employeurabilité en présentent d’autres facettes. L’inclusion dans et par l’emploi est une facette essentielle. Il s’agit de la capacité des entreprises à sortir des sentiers battus en termes de recrutement, à s’ouvrir à la diversité plutôt que rester sur un profil de « candidat idéal », tout autant recherché par les entreprises concurrentes, à faire l’effort d’intégrer des personnes éloignées de l’emploi, voire d’en faire le but même de l’entreprise.
Recenser les pratiques
Au-delà du recrutement et de l’intégration, l’employeurabilité peut également être envisagée comme la capacité des employeurs à mettre en place des conditions – organisationnelles, managériales et RH – favorables au développement de l’employabilité interne comme externe de leurs salariés. On rejoint ici les notions d’employabilité supportée ou d’employabilité durable.
Face à la multiplicité des approches de l’employeurabilité, il nous a semblé utile d’en faire un recensement et un examen systématique afin d’y voir plus clair et de mieux caractériser cette notion. À partir d’une analyse lexicale puis thématique d’un corpus de 75 textes académiques et non académiques (articles de presse, rapports d’organisations publiques, articles émanant du monde associatif ou syndical) faisant nommément référence à l’employeurabilité, nous avons abouti à une représentation synthétique des enjeux et pratiques associées.
Note de lecture : 34 % des enjeux évoqués dans les textes du corpus concernent « la capacité des employeurs à gérer la relation d’emploi » et 45 % des pratiques d’employeurabilité évoquées dans ces mêmes textes relèvent de l’appui externe à l’employeur.
Qui sont les bons employeurs ?
À partir des associations d’enjeux et de pratiques d’employeurabilité les plus fortement corrélées, cette recherche nous a finalement permis d’envisager trois types de réponse à la question « Qu’est ce qu’un bon employeur ? »
- Un employeur qui est en mesure de mobiliser les outils et méthodes de gestion adaptés (RH, organisation, management) pour attirer et fidéliser les talents dont il a besoin dans un objectif final de maximisation de l’efficacité de l’entreprise. Les pratiques liées à l’amélioration de la qualité de l’emploi déjà citées font partie de cette catégorie, de même qu’une communication réaliste des éléments d’attractivité d’une offre d’emploi.
- Un employeur qui, au-delà de sa fonction d’entrepreneur, est capable de gérer de façon équilibrée et durable la relation d’emploi, y compris, si besoin, en faisant appel à un appui externe ou à travers de la mutualisation. Par exemple, le recours à une aide externe par les TPE et PME peu outillées sur le plan RH, peut contribuer à faire émerger auprès des employeurs novices une identité d’employeur, centrée sur la capacité d’écoute et d’accompagnement du salarié vers son autonomie, et sur l’anticipation de ses besoins.
- Un employeur qui, s’éloignant de recherches de rentabilité financière directe) ou d’habillage social), déploie une responsabilité sociale élargie dans le champ de l’emploi à travers des pratiques d’inclusion et de développement de l’employabilité de ses salariés. Certaines pratiques d’embauche et de développement du pouvoir d’agir de publics particulièrement éloignés de l’emploi entrent dans ce cadre.
Une question de taille
La notion d’employeurabilité invite, finalement, à dépasser la dimension morale que revêt le mot « bon » accolé à celui d’employeur pour réfléchir de manière factuelle et différenciée, selon la taille des employeurs.
Pour ce qui est des petites structures employeuses (à but lucratif ou non) : comment mieux former les entrepreneurs au rôle d’employeur, les accompagner dans leurs premiers recrutements, renforcer l’appui des intermédiaires de l’emploi, développer les solutions de mutualisation de l’emploi ?
Pour les employeurs de taille intermédiaire : comment améliorer l’offre de conseil RH adaptée à leurs moyens et problématiques spécifiques ? Enfin, pour les grandes entreprises, comment les inciter, ou les contraindre par la loi, à adopter des comportements s’inscrivant dans un esprit de « stakeholder » et non pas seulement de « shareholder » ?
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.