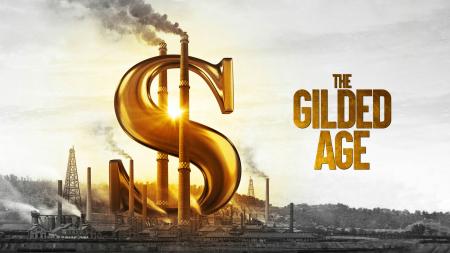Dans les carrières sportives, les émotions jouent un rôle central. Au-delà de la joie intense associée à la réussite et au dépassement de soi, certains récits d’athlètes illustrent la fragilité psychologique qui peut émerger sous la pression constante du haut niveau. Par exemple, le footballeur Thierry Henry a révélé avoir souffert de dépression pendant sa carrière. Il s’agit d’une confession encore rare parmi les sportifs, même si d’autres témoignages marquants ont émergé dans les médias, comme ceux de la gymnaste Simone Biles ou du nageur Michael Phelps.
Les émotions sont un élément fondamental de l’expérience du sport de haut niveau, à tel point qu’elles façonnent les trajectoires des athlètes. Elles jouent un rôle particulièrement visible lors des périodes de transition. En 2022, Roger Federer met fin à sa carrière. Une photo devenue iconique le montre en larmes, main dans la main avec Rafael Nadal, tous deux submergés par l’émotion. Cette image illustre la puissance émotionnelle de ces moments charnières, même pour les figures les plus emblématiques du sport.
Pourtant, jusqu’à présent, les émotions restent souvent peu prises en compte dans l’accompagnement des sportifs de haut niveau, ce qui révèle un paradoxe et souligne la nécessité d’un changement d’approche. Les enjeux sont d’importance, tant en termes de performance que de santé.
Nos recherches s’inscrivent dans cette perspective, en cherchant à décrire, comprendre et accompagner les émotions des athlètes lors des transitions dans les carrières sportives de haut niveau.
Les émotions associées aux transitions dans les carrières sportives
Les carrières sportives de haut niveau ne sont pas linéaires, mais jalonnées de transitions qui influencent l’expérience des athlètes, leur rapport à soi, aux autres, plus globalement encore leur relation au monde.
Dans son sens général, la transition correspond au passage d’un état à un autre, d’une situation à une autre. Elle se situe à proximité des termes de changements, de mutations, de crise(s) et d’épreuves. Il est classique d’envisager six grandes étapes transitionnelles dans la carrière des athlètes : le début de la spécialisation, le passage à un entraînement intensif, l’entrée dans le haut niveau, la professionnalisation, le déclin des performances et l’arrêt de carrière.
Ces transitions, qu’elles soient normatives (prévisibles) ou non normatives (imprévues), ne sont jamais dénuées de résonance émotionnelle. Par exemple, l’entrée dans le haut niveau peut générer de l’excitation, de la fierté, tandis qu’une blessure peut susciter frustration, peur ou découragement. L’expérience de ces transitions est singulière à chaque athlète : les significations qu’ils attribuent à ces moments clés façonnent leur potentiel à surmonter les obstacles et à maintenir leur engagement. Cela nécessite de l’individu la mise en œuvre de stratégies d’adaptation plus ou moins conscientes.
Dans nos recherches, nous menons des entretiens approfondis portant sur le « cours de vie » des sportifs de haut niveau. En prenant appui sur une frise chronologique représentant les moments marquants de leur carrière, nous les accompagnons progressivement dans la mise en évidence de périodes charnières, puis dans l’explicitation de leur expérience. L’objectif est de reconstruire la dynamique de leurs émotions tout au long de leur parcours sportif, afin de mieux comprendre comment ils vivent, interprètent et traversent ces transitions.
Les émotions dans la carrière d’un pongiste de haut niveau
Nous avons réalisé une première étude avec un pongiste français de haut niveau, dont le témoignage met en lumière les émotions marquantes d’une carrière de plus de vingt ans. Après une progression rapide dans ce sport, l’intégration dans l’équipe de France constitue une source de grande fierté : « Je commence à avoir des rapports privilégiés avec le champion du monde », se souvient-il. Cette transition, de jeune espoir à membre reconnu de l’équipe suscite un optimisme débordant. Elle ouvre un large champ des possibles pour le pongiste, par exemple celui de pouvoir participer aux Jeux olympiques.
Toutefois, les transitions ne sont pas toujours vécues de manière positive. Après cette progression vers le haut niveau, le pongiste fait face à une blessure : « C’est une année pourrie à cause de ça », raconte-t-il. Plus tard dans sa carrière, après un départ à l’étranger, il vit une période de doute et de remise en question :
« Pendant trois mois, je ne gagne pas un set, et j’ai l’impression de ne plus savoir jouer. Tous les matins, je me lève pour aller m’entraîner et, dès qu’il y a un petit grain de sable, j’explose. Je ne suis plus sélectionné en équipe de France. Tu te dis, c’est fini. »
Avec l’aide d’un nouvel entraîneur, il reprend progressivement confiance, en acceptant d’abord de jouer à un niveau inférieur. Plus tard, conscient de l’élévation du niveau international, il réoriente ses ambitions :
« Je me dis que je vais essayer de vivre les belles choses qui restent à vivre, notamment des titres de champion de France. »
Le pongiste accepte de ne plus viser les compétitions internationales les plus prestigieuses, mais s’engage dans un projet plus personnel et accessible, nourrissant ainsi un épanouissement renouvelé jusqu’à la fin de sa carrière. Ces quelques extraits issus d’une étude de cas beaucoup plus large, illustrent au fur et à mesure des transitions successives l’émergence d’une passion, l’expérience du burn out, ou encore un fort potentiel de résilience.
Les émotions dans la carrière d’une planchiste de haut niveau
Nous avons réalisé une deuxième étude (en cours de publication) portant sur le parcours d’une planchiste de haut niveau en planche à voile. Après une non-qualification aux Jeux olympiques de Sidney, malgré son statut de première au classement mondial, elle vit une expérience difficile : « Tout le monde me voyait aux Jeux », confie-t-elle. Cet échec, difficile à accepter, permet une prise de conscience cruciale : sa stratégie était trop centrée sur elle-même, sans tenir compte de ses adversaires. Cela devient un moteur de sa progression : « Là, je me dis, les prochains Jeux, j’y serai. »
Quatre ans plus tard, elle remporte l’or aux JO d’Athènes, fruit d’une préparation méticuleuse. Mais cette victoire, loin de marquer la fin de son parcours, génère des questionnements sur la suite de sa carrière. L’épuisement physique et la diversification des aspirations personnelles la poussent à envisager une reconversion : « Pourquoi continuer ? », se demande-t-elle. Le changement de matériel (une nouvelle planche) est également problématique pour cette sportive. Cette période débouche sur un échec aux JO de Pékin qu’elle vit douloureusement. Mais simultanément, « c’est une véritable libération », affirme-t-elle, se rendant compte qu’elle était prête à quitter la compétition de haut niveau.
Elle choisit alors de se réinventer en devenant cadre technique, transmettant son expérience aux jeunes athlètes :
« Je veux qu’on me voie autrement, pas comme une athlète, mais comme quelqu’un qui transmet. Je vais reprendre rapidement du plaisir à accompagner les jeunes. Je vais pouvoir transmettre mon expérience, je vibre à travers les athlètes. »
Cette transition met en lumière un fort potentiel de résilience et une capacité à se réinventer en dehors de la compétition, ouvrant ainsi une nouvelle voie à l’épanouissement personnel et professionnel. Ces quelques extraits illustrent l’ambivalence des défaites et des victoires, l’alternance d’émotions positives et négatives au fur et à mesure des transitions, et un fort potentiel de résilience.
Prendre en compte les émotions pour accompagner les sportifs dans leurs transitions
Nos recherches actuelles sur les carrières sportives, principalement celles des athlètes ayant participé aux Jeux olympiques, visent à analyser les similitudes et différences en termes d’émotions dans l’expérience des transitions. Nous nous efforçons de multiplier les études de cas afin de mieux comprendre à la fois la singularité des trajectoires individuelles et les éléments de typicalité. Ces études permettent de mieux comprendre l’impact du contexte (social, culturel, institutionnel), des relations interpersonnelles (entraîneurs, coéquipiers, famille), des caractéristiques sportives (type de sport, exigences spécifiques), ainsi que des caractéristiques individuelles (sensibilité, culture) sur l’expérience des transitions.
Nos recherches offrent des points de repère précieux pour penser et ajuster l’accompagnement des athlètes. Il est intéressant de travailler en amont des transitions pour les anticiper, pendant cette période, mais aussi après. Des dispositifs reposant sur les entretiens approfondis, permettent aux sportifs de mettre en mots leurs émotions, de les partager, de donner sens à leur expérience des transitions, d’envisager des stratégies d’adaptation.
Également, lorsqu’un sportif écoute le récit d’un autre athlète, il peut identifier des situations similaires, des émotions partagées ou des stratégies communes, ce qui favorise la transférabilité de l’expérience et peut nourrit sa propre progression.
Enfin, sensibiliser les entraîneurs et les structures sportives à la dimension émotionnelle est essentiel pour favoriser l’épanouissement des athlètes à tous les stades de leur parcours. À ce titre, l’intégration de cette thématique dans les formations constitue un levier important.
D’ailleurs, cette réflexion gagnerait à être étendue à l’analyse des carrières des entraîneurs de haut niveau, eux aussi confrontés à de nombreuses transitions au cours de leur parcours. Mieux comprendre le rôle des émotions dans ces étapes charnières permettrait d’éclairer les enjeux spécifiques de leur trajectoire professionnelle, souvent marquée par l’instabilité, l’adaptation constante et des remises en question profondes.
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.